La lente élaboration du congé maternité entre 1810 et 1938 | Progrès et ambiguïtés
Lettre du comité Jeunes chercheurs du CHATEFP n°2 | Février 2025 | Marie-Charlotte Julien
Publié le |
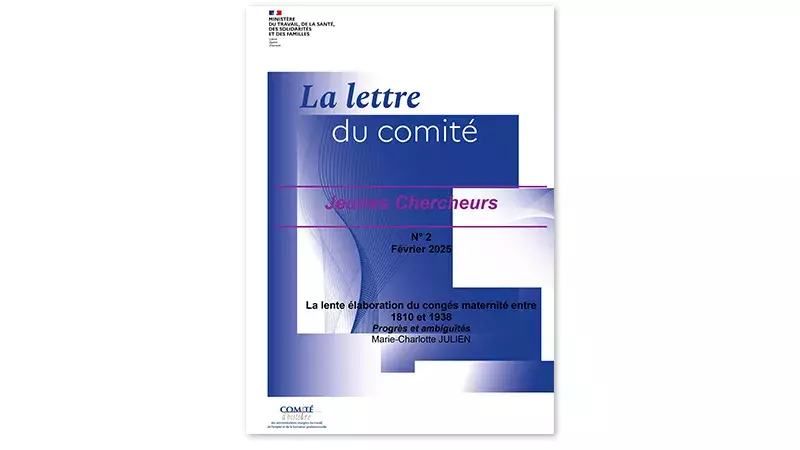
Cette deuxième Lettre « Jeunes chercheurs » du Comité d’histoire des administrations chargées du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (CHATEFP) donne la parole à Marie-Charlotte Julien, historienne du droit, pour sonder la profondeur historique d’une politique publique : l'élaboration du congé maternité de 1810 à 1938.
Ce travail repose sur la confrontation de trois approches :
- L’histoire du droit marque les grandes dates de l’élaboration du congé maternité : la loi de 1810, avec le déploiement de la société de charité maternelle sur l’ensemble du territoire ; celles de 1909 et 1913 qui établissent les règles du congé maternité et le décret-loi de 1936 qui augmente les allocations familiales lorsque les femmes arrêtent de travailler ;
- L’analyse du contexte socio-économique éclaire sur la façon dont les acteurs s’emparent du droit du congé maternité, du côté des patrons, des féministes et des mouvements natalistes. Le recours aux archives des différents protagonistes fonde la présentation de leurs positions.
- Les monographies de trois entreprises du secteur textile, enfin, réalisées à partir des archives locales et de dictionnaires biographiques donnent chair à sa thèse.
Qu’en est-il aujourd’hui, plus de 50 ans après la période étudiée : 1810-1938 ?
Les progrès sont indéniables. Dans cette Lettre, Marie-Charlotte Julien évoque le cas de certains patrons « qui considèrent que la femme enceinte, dès lors qu’elle ne vient plus à son poste, peut être licenciée ». Un autre cas est décrit, celui de « Marie Chambin qui rejoint le syndicat de la Poste en 1900, mais s’en fait exclure dès qu’elle fait état des revendications du personnel féminin, dont fait partie le congé de maternité ». Aujourd’hui la loi et les règlements bannissent de telles pratiques, contraires au Code du travail et considérées comme discriminatoires.
Et pourtant, la situation des femmes sur le marché du travail reste fragile. Sans revenir sur les inégalités salariales entre hommes et femmes, sur la part des femmes dans le temps partiel, un seul chiffre suffit à montrer que la maternité au travail est en soi une dimension à prendre en compte : la part des mères de 25 à 49 ans dites « inactives » selon l'Insee (c'est-à-dire sans emploi et qui n'en cherchent pas), en 2020, passait ainsi de 12 % à 17,8 % à la naissance du premier enfant, à 25 % avec deux enfants dont au moins un de moins de 3 ans et à 52,5 % avec plus de trois enfants.
À lire également
-
Le Comité d’histoire des administrations chargées du travail de l’emploi et de…
Le CHATEFP (Comité d’histoire des administrations chargées du travail de l’emploi et de la formation professionnelle) a été créé…
Acteurs
Date de mise à jour le
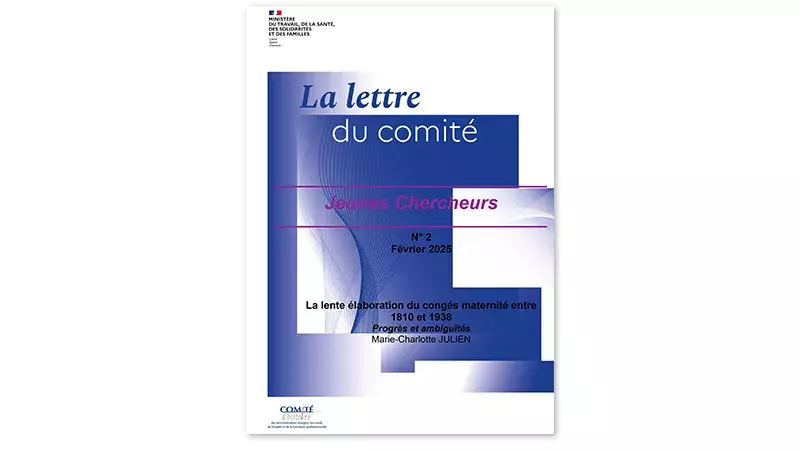
-
Le congé de maternité
Les femmes salariées bénéficient, avant et après l’accouchement, d’un congé de maternité pendant lequel leur contrat…
Fiche pratique
Date de mise à jour le
